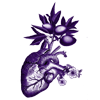Entretien mené dans le cadre d’un cursus de didactique visuelle
Depuis 2013, l’association Polyvalence publie et diffuse des fanzines qui mettent en valeur le témoignage individuel – sur les violences, le corps, la sexualité, le genre ; sur des choix de vie aussi, comme le véganisme ou la polyamorie. Si la démarche est thérapeutique pour les personnes qui témoignent comme pour celles qui les lisent, elle permet aussi de sortir de la spirale du silence qui entoure des sujets intimes et souvent tabous. J’ai rencontré Tan, la créatrice de Polyvalence. On a parlé de féminisme, de migration, de fanzines, de sexe et de liberté. Et aussi, surtout, de libérer la parole. – juin 2017
Tout d’abord merci d’avoir accepté cet entretien. Pourrais-tu te présenter ?
Je m’appelle Tan, j’ai fait des études d’anthropologie et de sexologie, et j’ai fondé l’association Polyvalence il y a quatre ans. Aujourd’hui je suis activiste multi-task et anthroposexologue au sein de cette association.
Comment est née Polyvalence ?
C’est une question qu’on me pose souvent et c’est difficile de répondre. Ça s’est fait comme ça, je n’avais pas de plan d’attaque.
Le côté institutionnel, l’association de loi 1901, a été créé fin 2015, parce que je voulais avoir un statut pour prétendre à des subventions. C’est beaucoup plus facile quand on est répertorié !
Mais le projet de Polyvalence, les prémices, c’était il y a quatre ans. J’aime beaucoup écrire, c’est assez thérapeutique pour moi, c’est ma façon d’interagir avec le monde. Des amis m’ont dit : « tu écris bien, tu devrais monter un blog ». Je ne savais pas bien quoi raconter dans un blog ; c’est une sorte de faux journal intime, ou alors des billets d’humeur, ce que je trouve parfaitement compréhensible et chouette pour certaines personnes (je le fais sur Facebook pour déconner avec mes contacts), mais raconter mes visions sur le monde et la vie, c’est pas trop mon truc. Par contre, j’écris des textes, un texte notamment, sur des violences que j’avais vécues. Je me suis demandé pourquoi j’avais envie de le publier ; pourquoi est-ce que j’avais envie que d’autres personnes le lisent. Pourquoi est-ce que j’avais envie que ce soit validé ? Pourquoi ce besoin d’une forme de reconnaissance ? Pourquoi avoir besoin d’une piste d’atterrissage à mon récit ?
Parallèlement, je me suis aussi dit que j’avais peur de le publier parce que la personne dont je parle dans le texte était un gros connard (rire), et sans avoir peur pour ma vie, il y avait un moment où quand tu es perpétuellement rabaissée et humiliée tu deviens un peu fragile et con. Moi j’étais un peu fragile et conne, et je me disais que je n’avais pas envie qu’il me balance un vieux truc dans la gueule devant des gens. C’est assez désagréable comme situation et je ne suis pas quelqu’un de passif. Je me suis dit qu’on était beaucoup à être dans ce cas-là. Je me suis dit qu’au lieu de baisser la tête en disant « touchez ma bosse, Monseigneur, pardon pardon d’exister », on était peut-être plein à avoir envie d’exister justement et à avoir envie de parler de choses qui nous étaient arrivées et dans lesquelles on patauge, d’où on est sorties ou d’où on n’arrive pas à sortir. J’ai lancé un appel à témoignages sur Facebook, j’aime beaucoup l’interaction sociale virtuelle que ça permet. Je considère ces trucs-là comme des outils, je ne m’en sens pas prisonnière, je ne trouve pas que ce soit une drogue horrible.
J’ai reçu plein de témoignages. Avec une amie graphiste et peintre, on voulait exposer dans un bar communautaire militant et faire des diptyques : un texte, une illustration, puis les vendre et reverser les bénéfices à des associations qui luttaient contre les violences sexistes. À l’époque, on ne voyait pas très bien comment monnayer les textes, qui étaient des témoignages et ne venaient donc pas de nous ; on ne savait pas très bien ce qu’on allait faire mais ça partait d’un bon sentiment. Au final, j’ai reçu énormément de témoignages et il est devenu impossible de tous les illustrer. J’ai donc lancé sur Facebook un autre appel pour trouver des gens pour faire des illustrations.
Je trainais dans les milieux anarchaféministes. On se connaît dans ces milieux, l’information a circulé et j’ai reçu pas mal de réponses de gens qui voulaient illustrer, écrire, organiser des choses, mettre la main à la pâte. On a édité des formats papier et peu à peu plusieurs personnes se sont fédérées autour de ça.
Le mot « Polyvalence », c’est parce que je n’arrêtais pas de dire « polyvalence, mon pote ! » et un copain m’a dit « Mais fais-toi tatouer ce truc, là, c’est ta grande phrase ! » – et effectivement je l’ai fait tatouer. Tout, dans ma vie, que ce soient mes études, ma vie personnelle, ma façon de gagner de l’argent, mes occupations ou mes centres d’intérêt, est toujours imbriqué et lié.
Au début ça s’appelait donc Polyvalence, mon pote. C’est comme ça que ça a commencé.
Qui travaille avec toi à Polyvalence ?
Les gens entrent et sortent régulièrement. Beaucoup de gens ont envie de participer, parce que ça les intéresse et parce qu’on a une bonne aura. On est sympa et on fait des choses bien. C’est un peu naïf dit comme ça, mais je pense que les gens ont envie de participer à quelque chose qu’ils estiment utile.
Moi, je suis toujours là. Plusieurs personnes ont aidé sur le site mais c’est Emi principalement qui s’en occupe depuis le début. Il y a eu Léo qui nous aidées sur des choses administratives un peu rébarbatives, et c’est très bien, parce que moi, dès que je touche un tableau Excel, j’ai l’impression que je vais faire exploser mon ordinateur. Il y a aussi un pôle accessibilité (des vidéos en langue des signes française notamment, ndlr), plus ou moins bien exploité selon les périodes.
Il y a aussi les actions auprès des réfugiés. J’ai travaillé sur les violences sexuelles dans les parcours migratoires. Mago a rejoint Polyvalence l’année dernière et s’occupe d’organiser des rencontres avec des personnes réfugiées. Nous avons un local dans le plateau urbain des Grands Voisins, situé dans l’ancien hôpital Saint-Vincent de Paul, à Paris, réaménagé provisoirement pour accueillir des associations. Ça nous donne accès à des salles pour stocker des choses et organiser des évènements. Mago y organise ce qu’on appelle les Journées de solidarité, ainsi que des rencontres, des discussions, des projections… Elle a aussi été très active dans les camps de réfugiés à Paris.
Il y a Manu, qui nous a rejointes au moment de la création de l’association, il y a un an et demi. Il s’occupe de recueillir des témoignages et des images à Calais et à Paris auprès des réfugiés. Il va d’ailleurs bientôt retourner à Calais, parce qu’on a un projet, on ne va pas juste laisser tomber.
Il y a d’autres personnes qui circulent, mais tout ça demande un investissement personnel assez conséquent, d’abord parce que je suis très rigoureuse et que je ne veux pas que les choses soient faites à moitié ; et aussi parce qu’on s’occupe d’êtres humains et de leur survie. Bon, on n’est pas non plus une association humanitaire dans un hôpital en Syrie, un peu d’humilité tout de même. Il y a plein de gens qui aident et quand les personnes arrivent à rester motivées sur un projet du début à la fin, c’est super bien. Quand ça s’arrête en plein milieu, c’est un peu chiant, voire carrément épuisant. Je dois tout rattraper, parce que je ne peux pas laisser les trucs tomber, tu vois. Si, par exemple, j’organise un nouveau fanzine et que d’un coup d’un seul la personne qui s’occupait du fanzine lâche, il faut que je m’en occupe. Je ne peux pas dire aux gens qu’on a sollicités, dont on a sélectionné les témoignages, « Bon, ben finalement, non, au revoir. »
Évidemment, tout le monde est bénévole et c’est ça qui fait que c’est compliqué. Tout le monde a des boulots, des vies. C’est prenant, de s’occuper de gens qui sont victimes de violences. Tu ne peux pas faire les choses à moitié. Quand tu commences à t’investir dans des choses comme ça, tu crées un vortex où les gens ont besoin de toi.
Comment en êtes-vous venu à travailler avec les réfugiés ? Peux-tu expliquer en quoi c’est important ?
Je ne trouve pas que ce soit très éloigné de ce qu’on fait avec les fanzines. Dans certaines associations féministes, il y a quelque chose de très revendicatif, d’agressif, que je trouve contre-productif. Moi je suis très contente que les hommes existent, ce n’est pas parce que je suis féministe que je suis misandre. Et quand on a commencé à aider les réfugiés, des gens nous ont dit « Vous surfez sur une vague parce qu’il y a un buzz, alors que c’est des mecs, c’est quoi le rapport ? »
Je trouve qu’il y a un rapport simplement parce que ce sont des êtres humains. Le fait que ce soit féministe, c’est simplement parce que comment ne pas être féministe dans la vie ? Ça ne veut pas dire que tous les autres, qui ne sont pas des femmes dramatiquement opprimées, doivent aller se faire foutre.
Je bossais dans des foyers d’accueil, des foyers de femmes victimes de violences. J’ai vu des réfugiés, j’en ai rencontré. Le titre de mon master, c’était Genre, culture et migration.
Je ne suis pas franco-française. Je pense que tu ne peux pas vivre en France sans être sensible à ce qui se passe. J’ai profité de la visibilité que Polyvalence commençait à avoir pour diffuser un appel à cagnotte pour aller à Calais, distribuer des dons. On avait accès à un grand local de stockage là-bas.
Au lieu de me dire « Oh là là c’est dramatique, c’est tellement triste, qu’est-ce qu’on peut faire ? », je me suis dit « Eh ben on va faire quelque chose ! » On a fait une première cagnotte, on a eu mille euros. À la deuxième, on en a eu 13000. Moi, je voulais aller à Calais récolter des témoignages dans les bidonvilles, notamment dans la Jungle. J’ai contacté un vidéaste pour qu’il m’aide en filmant pendant que je discutais avec les gens. Mais ça n’était pas une bonne idée finalement ; ça n’est pas forcément compliqué de filmer quelqu’un avec un Iphone et c’est même beaucoup plus simple que de sortir tout un attirail pour faire de belles images alors que ce sont des gens qui sont en train de crever dans leurs cabanes. Ça n’est pas un studio de tournage.
On est allés à Calais plusieurs fois, Manu est venu avec moi. Et puis le jour où je voulais vraiment aller recueillir des témoignages, on m’a proposé une interview pour Causette. C’était important d’avoir aussi de la visibilité de ce côté-là. J’ai dit à Manu d’y aller avec le vidéaste, je pouvais si besoin les aider à préparer les entretiens et traduire des choses en anglais (je suis aussi Américaine). La situation là-bas était compliquée, mais ce qu’on avait à faire ne l’était pas. Ils sont partis pendant que je restais à Paris pour répondre à l’interview.
Le jour où ils sont arrivés, le démantèlement de la Jungle a commencé. Quand tu arrives dans un bidonville qui est en train de se faire dégager, tu ne peux pas juste rien faire. Ils se sont retrouvés dans un truc très violent, psychologiquement et physiquement. Il y a eu des photos, la presse est venue. J’ai demandé à Manu de poster sur les réseaux sociaux ce qui était en train de se passer. C’est comme ça que ça a commencé à Calais. On a fait les collectes, Mago est arrivée à ce moment-là. Elle a aidé au début et elle a fini par organiser des rencontres.
Si quelqu’un a une idée et envie de la réaliser, on fonce. On s’appelle Polyvalence, pas Féministes françaises très gentilles ou je ne sais pas quoi. Maintenant, on a une légitimité, on a prouvé qu’on faisait les choses de manière éthique, avec des gens motivés et investis. Ça a un impact positif. On verra bien qui sont les prochaines personnes qui nous solliciteront pour qu’on les aide, qui sont les prochaines personnes qui nous solliciteront pour aider. Je vais dire un truc hippie illuminé nunuche, mais depuis qu’on a commencé, ça génère une énergie hyper positive et ça tient au fait que toutes les personnes qui viennent sont des bonnes personnes, parce que cette association est une bonne association. C’est un cercle vertueux.
Quelle réception avez-vous des fanzines ?
Les gens qui les ont entre les mains disent que c’est très bien, qu’ils sont très beaux. Mais on est toujours un peu en dèche d’illustrations.
Il y a eu cinq fanzines sur les violences sexistes faits dans la même année, puis un fanzine pour les ados. Aujourd’hui, on a reçu les 400 fanzines qu’on va distribuer dans des lycées en partenariat avec une association qui fait des interventions en milieu scolaire. On a aussi six ou sept fanzines en préparation sur différents thèmes. Récemment, on a publié un fanzine autobiographique, l’histoire d’une femme qui raconte des choses terribles qui se sont passées dans sa vie. On n’a pas énormément de subventions pour imprimer. C’est toujours un peu du bricolage, mais ça permet aussi à chaque personne d’aider un peu, ça constitue des boucles de solidarité à tous les niveaux. Je voudrais que tous les fanzines aient la même ligne graphique et je compte me former à Indesign pour pouvoir aider à la conception graphique.
On a besoin d’argent et pour en trouver il faut faire des cagnottes qui servent ensuite à produire les fanzines, payer le loyer, financer les différents projets.
Il y a un d’autres fanzines en préparation qui tourneront plus autour de la sexualité. Parce qu’il y a un problème entre les humains et la sexualité.
Tu peux développer ?
Bien qu’on soit en France qui est traditionnellement un pays de droits, avec une Histoire érotique, ça n’empêche pas les gens d’être malheureux, frustrés, pas épanouis sexuellement. Tout le monde a une sexualité, même si c’est une asexualité. Même les enfants. Mais pour des raisons que je ne vais pas développer ici parce qu’on en aurait pour trois mois, ça reste un sujet sensible, épidermique et quand je vois les gens en consultation je trouve que ça ne va pas du tout. Ils sont malheureux et c’est dommage, parce que la sexualité, ça a un potentiel extrêmement plaisant et positif, mais ça ne l’est jamais entièrement. Il y a toujours mille choses derrière. Le témoignage, pour ça, c’est très important. Je peux expliquer certaines choses parce que j’ai une certaine expertise dans le domaine, mais je ne sais pas tout non plus. Je pense que le savoir empirique, profane, est tout aussi utile, voire davantage, que le savoir académique. Peut-être qu’il est le plus utile quand il est mis en lumière par un savoir expert. C’est à ça que servent les fanzines et c’est ça que j’explique ici.
Il y a par exemple un tabou énorme sur la maternité et la sexualité. Moi, je n’ai pas d’enfants. Je pense donc qu’il est beaucoup plus intéressant pour des patientes qui viendraient me voir avec des problèmes liés à ça d’avoir accès aux témoignages plutôt qu’à mon seul regard. Personne ne parle de certains sujets, comme le fait qu’une grossesse ça te déglingue le corps et ça peut te déglinguer beaucoup d’autres choses. Les témoignages permettent aux personnes qui ont été enceintes – je dis personnes parce qu’il y a, entre autres, aussi des hommes trans qui peuvent être enceints – de raconter des choses qu’elles n’oseraient pas dire autrement. Et ça permet ensuite à d’autres de les lire et de diffuser des expériences qui font que petit à petit, on se sent moins seule, on comprend les choses comme étant des faits sociaux, systémiques et pas juste quelque chose de très personnel dont on ne parle pas. Le témoignage est thérapeutique, mais aussi politique. Il est très important. Il faut que les choses soient dites. C’est une petite avancée, car ce n’est pas un fanzine de quinze témoignages qui va révolutionner la conception de l’amour, la vie, le féminisme et la sexualité, même si j’aimerais bien. Mais il faut bien commencer quelque part. Si ça a une utilité rien que pour les personnes qui viennent me voir en consultation, eh bien tant mieux, c’est le but. Je fais tous ces métiers-là pour aider les gens, et je voudrais qu’il existe des outils pour les aider.
Quand tu dis « en consultation », tu parles de tes consultations de sexologie ?
Oui. C’est difficile à résumer, alors je mets sur ma carte que je suis anthroposexologue. Je propose des consultations, mais aussi des formations, des discussions, des entretiens sur trois grands thèmes : corps, identité et sexualité. Les sous-thèmes sont les migrations, les pratiques rituelles – je m’intéresse à la sorcellerie et aux pratiques sexuelles rituelles – le travail du sexe – je suis dominatrice professionnelle – les troubles sexuels, la santé sexuelle et les violences.
Les personnes peuvent venir me parler. Le terme « consultation » peut être too much pour certains, alors ça peut juste être des discussions.
Y a-t’ il des gens dont tu te sens proche au niveau militant, sur le plan philosophique, intellectuel et politique ?
(Après un silence) Non (rire). Ça me paraît tellement évident, le féminisme, la liberté. Je ne me suis jamais dit en lisant une auteure féministe : « Tiens, je n’y avais jamais pensé avant », même si je suis d’accord avec ce qu’elles disent.
Moi, je suis anarchiste, vraiment, profondément. Je pense que tu ne peux pas être anarchiste sans être féministe. L’idée que les gens devraient être égaux, libres et épanouis, ce n’est pas quelque chose que j’ai lu un jour en me disant « Ah mais oui ! »
J’ai été élevée par une mère féministe, donc forcément, c’était comme ça. C’est aussi pour ça que je n’ai pas le côté revanchard, en colère, qu’ont certaines personnes. Je suis suffisamment convaincue pour créer des outils, qui deviendront des armes, mais je ne suis pas là à aiguiser mes lames. Ce n’est pas un jugement de valeur, mais je ne suis simplement pas dans un truc agressif. Je ne me bats pas contre quelque chose, je milite pour quelque chose. Bon, le terme militantisme ne veut plus rien dire non plus, mais disons que je suis convaincue par des idées, et je propose des actions auxquelles je crois. Et ce que je crois, c’est que les gens devraient être heureux, voilà, c’est tout ! (rires)
Comment vois-tu la suite ?
Je voudrais qu’on ait un nouveau local, parce que celui dans lequel on est va devoir être détruit en décembre. Pour la suite, je veux asseoir Polyvalence comme maison d’édition. Je veux aussi ouvrir une librairie / salle de consultation. En fait je veux ouvrir un espace polyvalent, avec des livres, avec des gens, sur des sujets qui m’intéressent, qui intéressent d’autres personnes et que je trouve essentiels, mais qui peuvent être aussi des trucs chouettes. Je m’occupe de sexualité, mais ce ne sont pas que trucs glauques ! Je ne m’occupe pas que de viols et de choses horribles ! Je m’occupe du corps, de la sexualité heureuse, des sensations, du plaisir… des choses comme ça, aussi.
Travailler sur des sujets compliqués mais en gardant l’aspect joyeux et euphorisant qu’il y a autour de ça, ça permet aussi de garder des forces pour s’occuper des cas dramatiques, parce que c’est quand même un peu hardcore parfois.
Et je veux que Polyvalence reste quelque chose de polyvalent. Les gens, les sujets, je veux que ça reste quelque chose de riche, et que le maître-mot de tout ça, ce soit le partage et la solidarité, et la diffusion des énergies positives.
Eh bien merci !
Eh bien de rien !